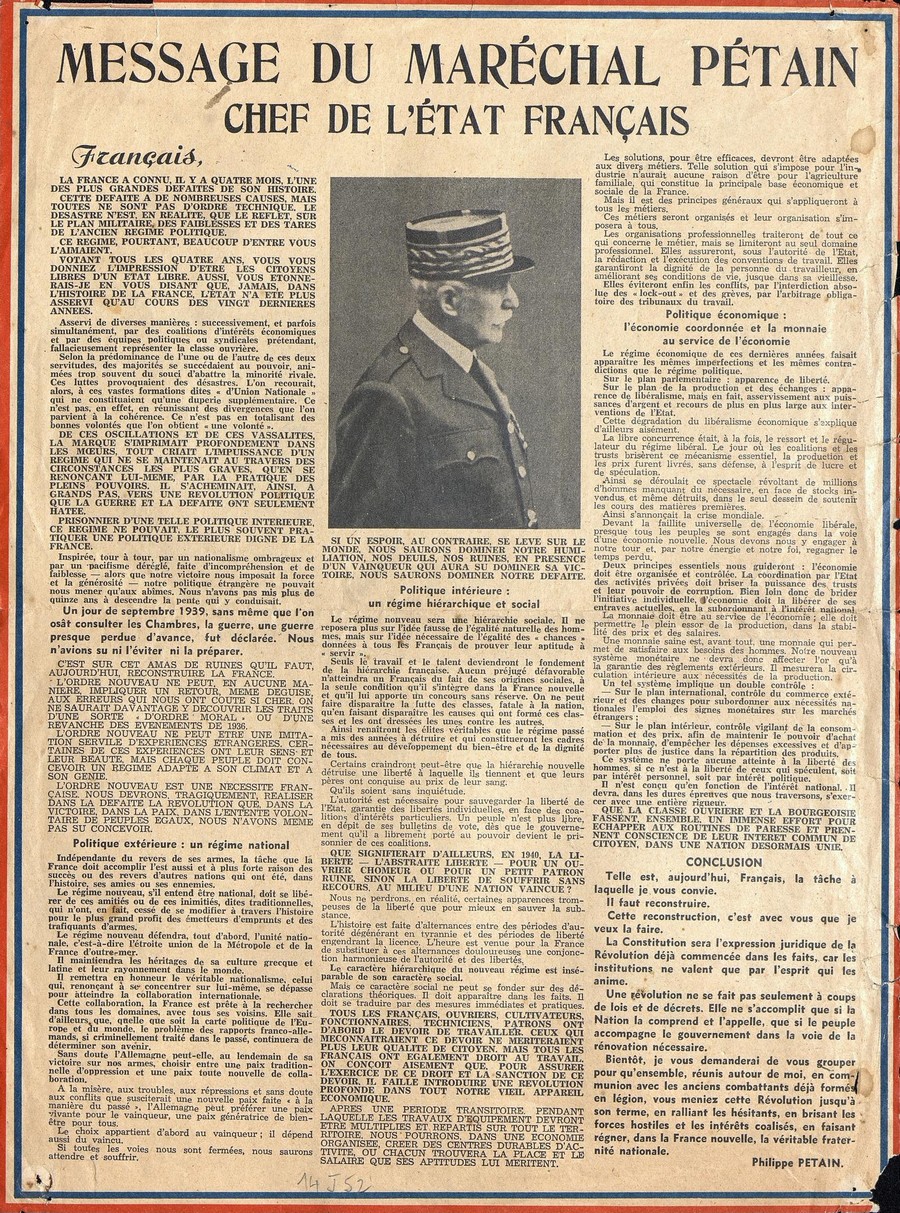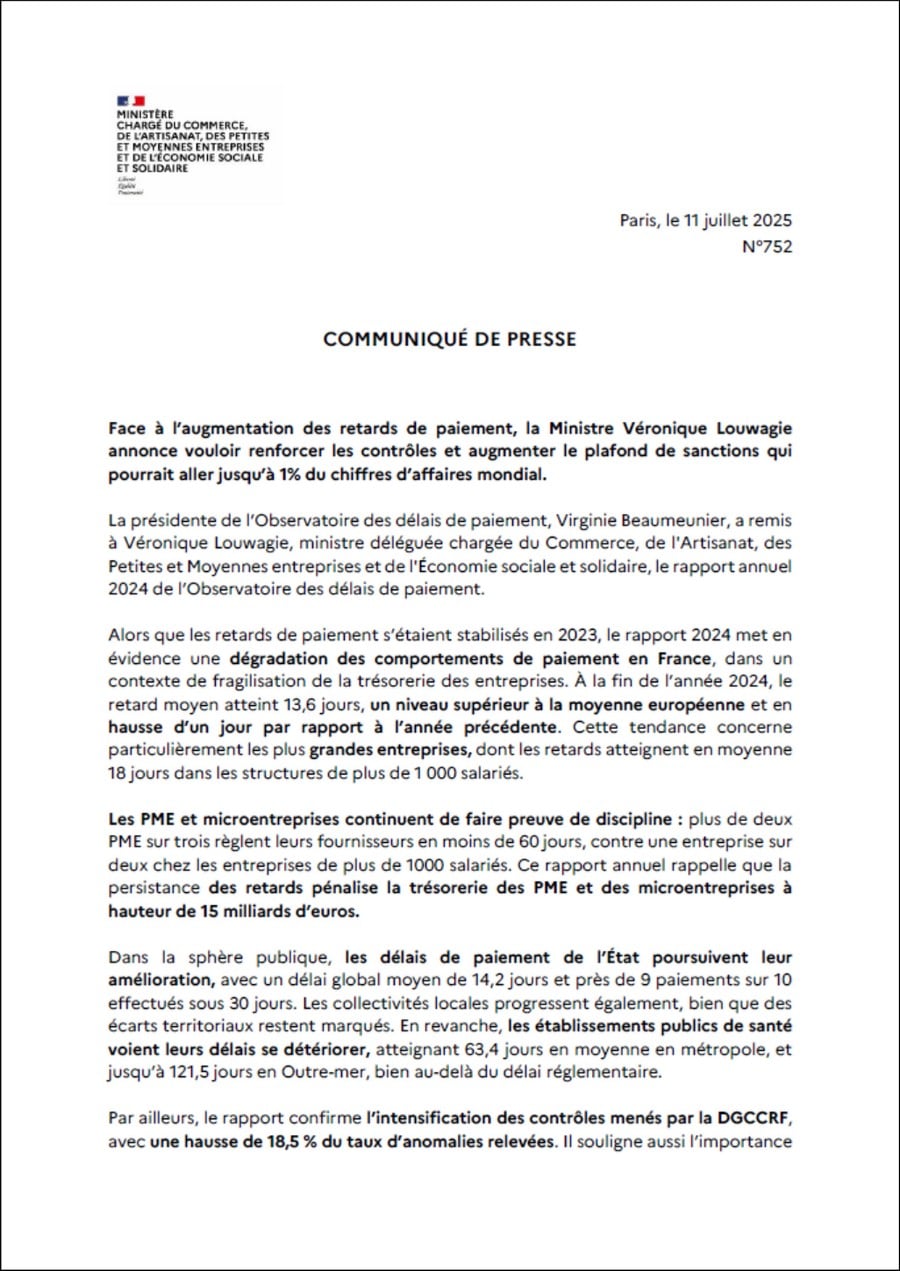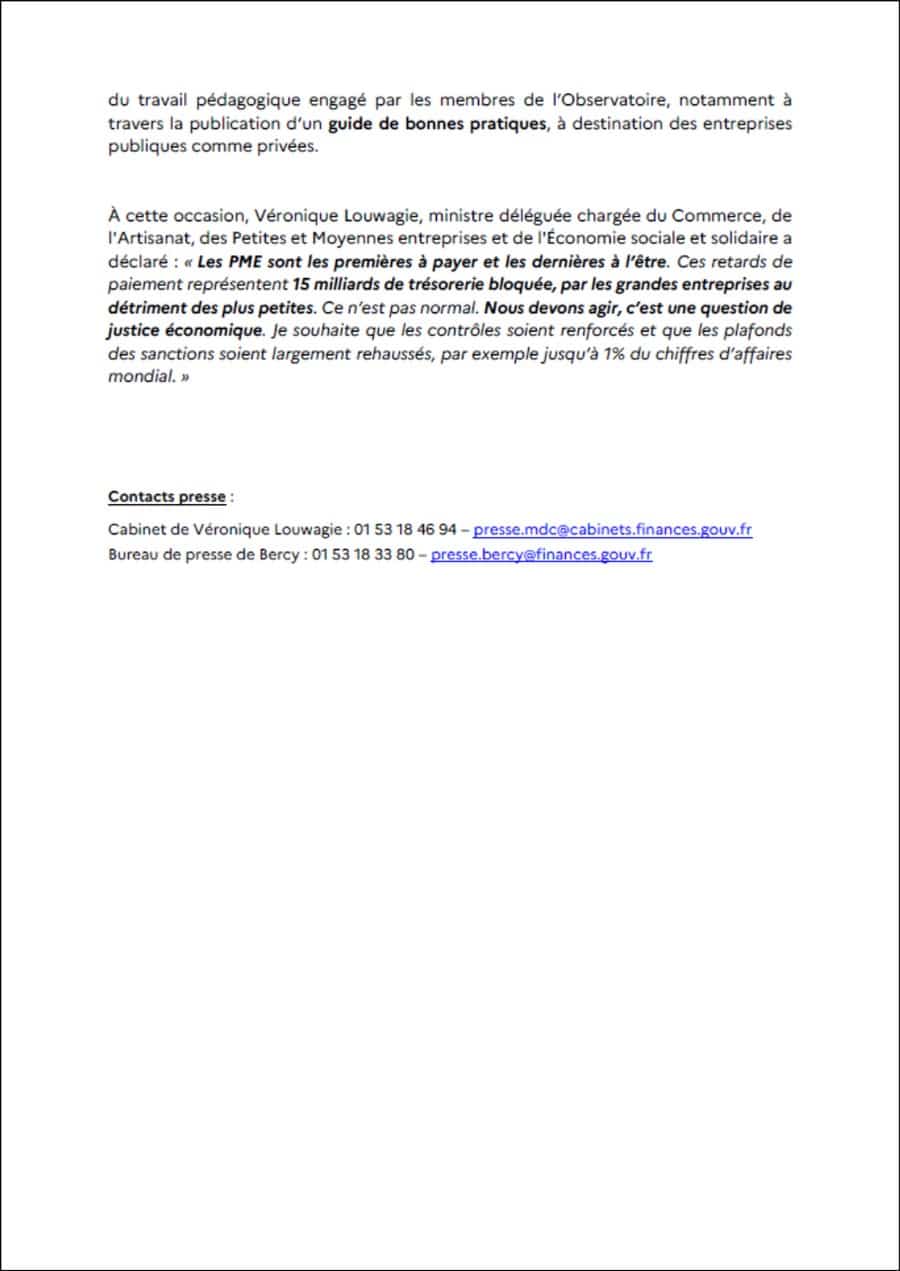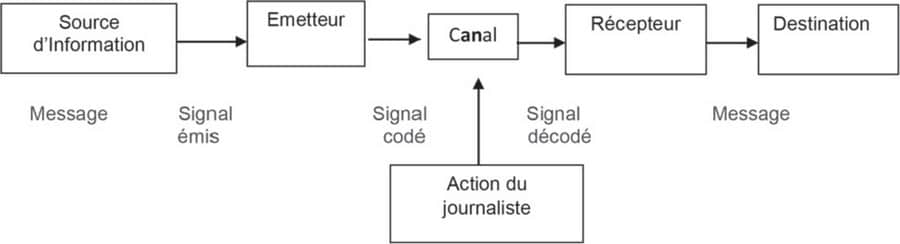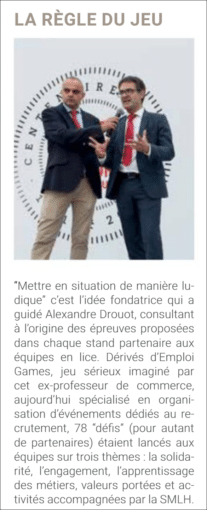Le marché de l’emploi en France connaît depuis plusieurs années une intensification des tensions. Loin d’être un phénomène conjoncturel lié uniquement à la sortie de crise sanitaire, ces déséquilibres s’inscrivent dans une dynamique plus profonde. Ils traduisent à la fois des difficultés structurelles de formation, des mutations sectorielles rapides et des évolutions dans les aspirations des travailleurs. L’artisanat, secteur historiquement résilient, en fournit une illustration exemplaire. Selon le dernier baromètre ISM-MAAF, malgré un niveau d’emploi encore élevé, les entreprises artisanales peinent à recruter, les offres progressant plus vite que le vivier de candidats disponibles¹. Ces constats rejoignent ceux dressés par la DARES et par l’INSEE, qui soulignent l’ampleur des tensions dans l’ensemble du tissu économique français².
Des tensions généralisées sur le marché de l’emploi mais différenciées selon les secteurs
En 2023, près de trois métiers sur quatre étaient considérés comme « en forte tension », couvrant environ 68% de l’emploi total³. Cette proportion constitue le plus haut niveau observé depuis plus d’une décennie. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie de production, ainsi que les services de proximité, concentrent la majorité des difficultés.
Dans l’artisanat, le baromètre ISM-MAAF relève une croissance spectaculaire des offres d’emploi : plus de 490 000 ont été publiées en 2024, soit une augmentation de 46% depuis 2019⁴. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi dans ces métiers a reculé de 12%. La combinaison de ces deux tendances explique l’ampleur des déséquilibres : pour certains métiers, plus de 80% des recrutements sont jugés difficiles. C’est le cas des couvreurs, chaudronniers ou carrossiers automobiles⁵.
Ces tensions ne sont cependant pas uniformes. Alors que certains métiers connaissent une raréfaction des candidats – charcutiers-traiteurs, plâtriers, soudeurs – d’autres, au contraire, voient affluer des vocations parfois au-delà des débouchés réels. Les brasseurs, fromagers ou pâtissiers, emblèmes de reconversions post-Covid, connaissent une hausse significative du nombre de demandeurs d’emploi⁶. Le marché oscille ainsi entre pénurie et excès d’offre, révélant une inadéquation croissante entre les trajectoires individuelles et les besoins collectifs.
Les ressorts des déséquilibres sur l’emploi en France
Plusieurs facteurs expliquent la persistance de ces tensions. D’abord, un déficit structurel de main-d’œuvre. Nombre de métiers artisanaux ou industriels souffrent d’un manque d’attractivité lié à des conditions de travail exigeantes, à une reconnaissance sociale limitée et, souvent, à une rémunération jugée insuffisante⁷. Les jeunes générations manifestent des attentes accrues en matière de qualité de vie au travail, de flexibilité et de sens accordé aux activités exercées.
Ensuite, une inadaptation territoriale. Les zones géographiques où les besoins sont les plus forts ne correspondent pas toujours aux bassins de main-d’œuvre disponibles. L’Île-de-France concentre ainsi plus de 1,7 million d’emplois en tension, soit près d’un tiers de l’emploi régional⁸. Les coûts et les temps de transport freinent les mobilités, accentuant les difficulties des entreprises locales.
Enfin, des transformations économiques rapides compliquent l’ajustement. La transition énergétique crée de nouveaux besoins (isolation, construction bois, réparation de cycles), tandis que la numérisation modifie les compétences requises dans la maintenance, l’automobile ou les métiers de service. L’offre de formation initiale et continue peine à suivre, malgré des dispositifs renforcés de reconversion et d’apprentissage⁹.
Conséquences économiques et sociales
Ces tensions produisent des effets multiples. Elles rallongent les délais de recrutement et limitent parfois l’activité des entreprises, qui doivent arbitrer entre retards, surcoûts et réduction de leur offre. Elles accentuent également les inégalités territoriales, certains services de proximité étant fragilisés par le manque de personnel.
Elles contribuent aussi à modifier les équilibres salariaux. Dans plusieurs branches, la rareté de la main-d’œuvre entraîne des revalorisations ou l’octroi de primes pour attirer les candidats. Ces ajustements, s’ils améliorent l’attractivité, peuvent aussi générer des tensions inflationnistes. Enfin, la multiplication des recrutements contraints ou partiellement qualifiés accroît le risque de précarisation, en particulier pour les jeunes et les reconvertis.
Perspectives et leviers d’action
Face à ce diagnostic, plusieurs pistes apparaissent.
- L’adaptation des parcours de formation aux besoins du marché demeure un levier essentiel : renforcement de l’alternance, développement de modules de reconversion plus souples, et meilleure articulation entre formation initiale et continue.
- L’amélioration des conditions de travail constitue une priorité pour redonner attractivité aux métiers en tension. Elle passe par la revalorisation salariale, mais aussi par des efforts sur l’organisation, la sécurité et les perspectives de carrière.
- La dimension territoriale doit être davantage intégrée. Les politiques publiques gagneraient à cibler les bassins les plus affectés, en développant des infrastructures de transport, des aides à la mobilité ou des formations locales.
- Enfin, la coordination entre acteurs publics et privés apparaît décisive. La mise en commun de données fiables, la concertation entre entreprises, collectivités et organismes de formation, ainsi qu’une anticipation partagée des besoins, conditionnent l’efficacité des politiques de l’emploi.
Les tensions actuelles du marché du travail français constituent à la fois un défi et une opportunité. Défi, car elles mettent en lumière les fragilités d’un système où l’offre et la demande peinent à se rencontrer, au détriment de la compétitivité des entreprises et de la cohésion sociale. Opportunité, car elles ouvrent la voie à une revalorisation de métiers essentiels, à une réflexion approfondie sur l’organisation du travail et à une meilleure reconnaissance des compétences. Pour la recherche en sciences de gestion, ces mutations offrent un terrain privilégié d’observation et d’analyse, où se jouent les équilibres futurs du travail et de l’emploi.
Philippe Naszályi
Notes
1. Baromètre ISM-MAAF, Les chiffres 2025 de l’emploi dans l’artisanat en France, communiqué du 4 septembre 2025.
2. INSEE, « Marché du travail : tensions sur le recrutement en Île-de-France », Insee Analyses Île-de-France, n° 164, 2023.
3. DARES, « Les tensions sur le marché du travail en 2023 », Dares Résultats, n° 54, juin 2024.
4. Baromètre ISM-MAAF, op. cit.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. France Stratégie, Métiers 2030 : quelles perspectives pour l’emploi en France ?, Rapport, 2022.
8. INSEE, op. cit.
9. France Stratégie, op. cit.