XIIIe Colloque Etienne THIL
7 et 8 octobre 2010
La Rochelle
Institut de Gestion
Sous la Présidence du Professeur Olivier Badot
ESCP Europe
IAE de Caen-Basse Normandie
Programme du colloque
| Jeudi 7 octobre |
|||
| 8h00 | Accueil des participants – Petit-déjeuner | ||
| 8h30 – 10h00 | Atelier 1 : Marketing stratégique des enseignes |
Atelier 2 : e-commerce |
Atelier 3 : Ressources Humaines |
| 10h00 – 10h20 | Pause | ||
| 10h20 – 10h30 | Mots de bienvenue | ||
| 10h30 – 12h00 | Table ronde :
Le commerce dans la main grâce à la viscosité électronique des smartphones animée par le Professeur Jean-François Lemoine |
||
| 12h15 – 13h45 | Déjeuner | ||
| 14h00 – 15h00 | Atelier 4 : Perspectives sociologiques et sémiotiques du commerce et de la distribution | Atelier 5 : Influences et critiques dans la distribution | Atelier 6 : Expériences d’achat et de magasinage |
| 15h00 – 15h15 | Pause | ||
| 15h15 – 16h45 | Table ronde :
Commerce de proximité et commerce en centres commerciaux : défis et articulations animée par le Professeur Olivier Badot |
||
| 16h50 – 17h50 | Décryptage de l’actualité 2010 et Prospective
C. Ducrocq, G. Bressolles, G. Barbat, J.G. Pierre, A. Bonsch |
||
| 17h50 – 18h15 | Remise du prix Etienne Thil-DiaMart de la meilleure communication
Présentation de la communication primée |
||
| 20h | Dîner de gala | ||
| Vendredi 8 octobre |
|||
| 8h00 | Accueil des participants – Petit-déjeuner | ||
| 8h30 – 10h00 | Atelier 7 : Prix et promotions | Atelier 8 : Organisation du réseau et du canal | Atelier 9 : Enjeux socio-éthiques dans la distribution |
| 10h00 – 10h30 | Pause | ||
| 10h30 – 12h00 | Table ronde :
Turbulences dans la distribution internationale : essais de prospective animée par François Bobrie |
||
| 12h00 – 13h00 | Un point sur l’histoire de la distribution | ||
| 13h00 – 14h30 | Déjeuner | ||
Programme des séances plénières
Jeudi 7 Octobre
10h30-12h00 : Le commerce dans la main grâce à la viscosité électronique des smartphones
Table ronde animée par le Professeur Jean-François LEMOINE, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (PRISM)
Intervenants :
– Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
– Patrick Brunier, Délégué général, Pôle de Compétitivité des Industries du Commerce
– Pr Alain Derycke, Université des Sciences et Technologies de Lille (sous réserve)
– Pr Brigitte Albrecht, Skema
– André-Benoît de Jaegere, Directeur « innovation », Cap Gemini Consulting
– Pr Joël Brée, IAE de Caen-Basse Normandie (NIMEC)
– Alexandra Vignolles, Inseec Business School
–Jean-Marc Lehu, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne
15h15-16h45 : Commerce de proximité et commerce en centres commerciaux : défis et articulations
Table ronde animée par le Professeur Olivier BADOT, ESCP Europe et IAE de Caen-Basse Normandie (NIMEC)
Intervenants :
– Christophe Carrier, Directeur Général, La Co-entreprise en stratégie
– Gwennaël Solard, Division « Commerce », INSEE
– Véronique Truffert, Responsable du département Développement et Performance Délégation des Hauts de Seine, CCIP
– Nadine de Lhopital, Responsable « Au Bonheur du commerce »
– Gaëlle Damilleville, Responsable Communication, Unibail-Rodamco
Vendredi 8 Octobre
10h30-12h00 : Turbulences dans la distribution internationale : essais de
prospective
Table ronde animée par François BOBRIE, IAE de Poitiers
Intervenants :
– Pr. Dominique Bouchet, University of Southern Denmark, Danemark
– Alain Thieffry, Consultant
–Adeline Ochs, Directrice, Topoye (en partenariat avec Unibail-Rodamco)
–Frédéric Perrodeau, Délégué Général, Institut Français du Merchandising
– Dan Gomplewicz, Responsable Etudes et Fidélisation, ED et Dia France
12h15-13h00 : Un point sur l’histoire de la distribution
– Yves Soulabail, Consultant-Formateur
– François Bobrie, Directeur du CEPE, IAE de Poitiers
– Philippe Faché, ICD Paris
– Mathias Waelli, Institut du Management, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – Rennes
– Camal Gallouj, EBS Paris et Université Paris 13 – IUT Saint Denis
Programme des ateliers
Jeudi 7 Octobre
Atelier 1 (8h30-10h) : Marketing stratégique des enseignes
– L’internationalisation des entreprises de service en association avec la
distribution : une analyse exploratoire,Daniele PEDERZOLI
– L’analyse du positionnement des enseignes leaders dans leur marché :
une approche par les représentations sociales des consommateurs, Anne-Marie LEBRUN, Lionel SOUCHET et
Patrick BOUCHET
– La segmentation fondée sur les
comportements d’achat des clients est-elle encore pertinente pour une enseigne de distribution multi-canal ?,Sandrine HEITZ-SPAHN
Atelier 2 (8h30-10h) : e-commerce
– Les effets de l’imagerie mentale issue de la présentation des produits
sur un site marchand : Proposition d’un modèle conceptuel par une approche exploratoire, Aurély LAO
– Analyse de l’univers
concurrentiel des sites de vente en ligne : une approche par le Web Analytics, Maria MERCANTI-GUERIN
– Distribution multi-canal : comment le site Internet d’une enseigne
modifie le rôle des vendeurs au sein du point de vente associé,Régine VANHEEMS
Atelier 3 (8h30-10h) : Ressources Humaines dans la distribution
– De l’OC des vendeurs à la fidélité à l’entreprise : Le rôle modérateur de
la propension relationnelle du client,Fanny POUJOL et Béatrice SIADOU-MARTIN
– Les fausses promesses de la polyvalence pour les managers de la grande
distribution,Magali BOESPFLUG
Atelier 4 (14h-15h) : Perspectives sociologiques et sémiotiques du commerce et de la distribution
- Images et figures du grand commerce dans la recherche en SHS :
quelles incidences sur l’attractivité du secteur, Camal GALLOUJ,
Mathias WAELLI et Philippe FACHE - La transposition de l’épopée sportive dans un point de vente : le
cas de la boutique running du Vieux Campeur,Jean-Baptiste WELTE et Patrick HETZEL
Atelier 5 (14h-15h) : Influences et critiques dans la distribution
– Critiques de la consommation et pratiques consuméristes : La
réduction de la dissonance par les justifications externes du comportement,Gilles SERE de LANAUZE et Béatrice SIADOU-MARTIN
– De la popularité à la capacité d’influence : Vos clients valent-ils
vraiment plus que ce que vous imaginez ?, Yves RIQUET, Patrick NICHOLSON et Pauline de
PECHPEYROU
Atelier 6 (14h-15h) : Expériences d’achat et de magasinage
– Le shopping dans un centre commercial : typologie de parcours et
expérience vécue,Aurélia MICHAUD-TREVINAL
– De l’expérience d’utilisation
vers l’achat : pour une meilleure prise en compte du système de consommation. Une application à l’habillement,Inès GUGUEN-GICQUEL
Vendredi 8 Octobre
Atelier 7 (8h30-10h) : Prix et promotions
– Le prospectus promotionnel, de la communication prix à la publicité
d’ambiance,Béatrice PARGUEL
– Doit-on arrêter de proposer des coupons de réduction ?,
Patricia COUTELLE, Véronique DES GARETS et Véronique PLICHON
– Vite et à tout prix ? La pertinence du prix dans la recherche
d’information pour les consommateurs en condition de pression temporelle, Jeanne LALLEMENT et Monique
ZOLLINGER
Atelier 8 (8h30-10h) : Organisation du réseau et du canal
– Un modèle décisionnel pour le choix statutaire des points de ventes dans
le cadre du management d’un réseau mixte de franchise : le cas des opérateurs des réseaux français de boulangeries,Samuel LAGRANGE et Pierre FENIES
– Capter la valeur en améliorant l’expérience du consommateur : le cas
Apple,Enrico COLLA et Madeleine BESSON
– Le concept de « roue du commerce » et l’historicité de l’évolution des formes de commerce, François
BOBRIE
Atelier 9 (8h30-10h) : Enjeux socio-éthique dans la distribution
– Distribution internationale et Responsabilité sociale de
l’entreprise : proposition d’un cadre d’analyse,Laure LAVORATA et Marc DUPUIS
– L’engagement en développement durable des distributeurs généralistes
est-il perçu par les consommateurs ?,Sophie MORIN-DELERM et Valérie CHARRIERE
– Une méthode d’évaluation du coût carbone lié aux déplacements des
consommateurs à l’intérieur d’une aire de marché, Michèle HEITZ, Jean-Pierre DOUARD et Erwan
BERNARDE
Informations pratiques
Le colloque se déroule dans les locaux de l’Institut de Gestion de
l’Université de La Rochelle, 39 rue de Vaux de Foletier (campus des minimes)
Pour venir depuis la gare SCNF ou le centre-ville
Les lignes de bus qui desservent le campus des Minimes sont : le n°17 (direction « Bongraine ») ou le
n°19 (direction « Aytré »).
Descendre à l’arrêt : Maison de la Charente-Maritime
Tel : 05 46 50 76 00 – Fax : 05 46 50 76 09



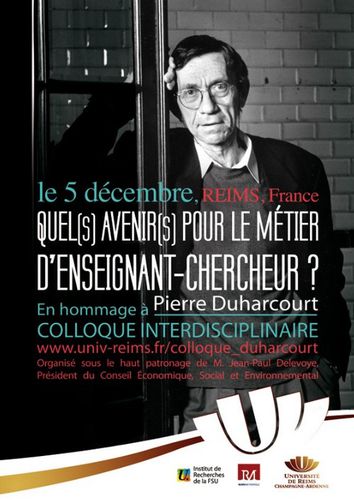

 Comme le philosophe Michel Serres ne cesse de le rappeler, il convient de «créer de nouvelles structures» car les «sociétés d’aujourd’hui sont trop vieilles et tombent en lambeau».
Comme le philosophe Michel Serres ne cesse de le rappeler, il convient de «créer de nouvelles structures» car les «sociétés d’aujourd’hui sont trop vieilles et tombent en lambeau».